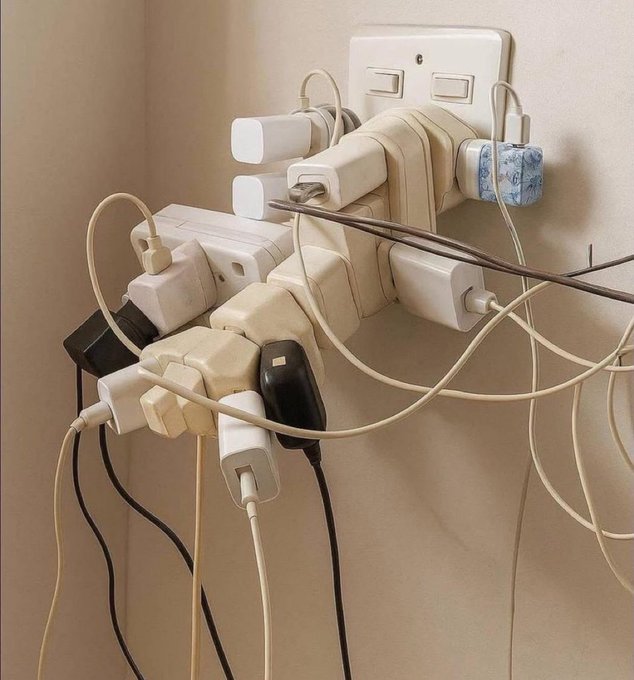Publié dans les Echos le 26 septembre
Retrouver le rapport « Sauver le service public de la dérosion » ici en téléchargement ou livré à domicile ici.
Chacun peut constater la dégradation des services publics – qu’il s’agisse de l’école, du système de santé ou de la recherche – alors que le poids des dépenses publiques atteint 58 % du revenu national. Nos politiques publiques subissent simultanément une dilution de leurs moyens sur des priorités toujours plus nombreuses et une érosion de leur qualité : c’est la « dérosion » des services publics étudiée par l’Observatoire du Long Terme[1]. Elle frappe avant tout les plus modestes, premiers touchés par la dégradation de l’école ou du système de santé alors que les plus aisés recourent de plus en plus au privé.
Le premier acte de cette dérosion date du dernier budget à l’équilibre en 1973. En octobre, l’OPEP quadruple le prix du pétrole et la croissance passe de 5,9 % par an de 1969 à 1973 à 3,1 % de 1974 à 1978. La France a maintenu ses dépenses en pariant sur le retour d’une croissance à 5 % et accumulé les déficits. Des experts ont théorisé la relance par la dépense publique : elle est mécanique à court terme mais son impact durable est difficile à identifier après 50 ans de pratique.
Deuxième acte, les critères de Maastricht en 1997, qui ont imposé ce que les Français auraient dû exiger de leurs dirigeants : fixer une limite aux déficits. Respecter ces critères en 1997 n’a pas été évident mais les années de croissance qui ont suivi (3,7 % de 1998 à 2001) ont permis de réduire les déficits sans efforts.
Troisième acte en 2005 : après un net ralentissement (croissance de 1,3 % de 2001 à 2003), les dépenses publiques sont depuis prises dans un étau à trois mors. D’abord, des déficits contraints. Ensuite, la fin de la baisse des taux des emprunts d’Etat (16 % en 1981, 3,4 % en 2005 et en 2025) qui avait fourni des économies sans effort. Enfin, une croissance faible (1,2% en moyenne depuis 2005).
Les dépenses publiques ne sont donc fortement sous pression que depuis 20 ans. Cette pression s’est exercée dans un contexte dans lequel une partie des dépenses, telles que les retraites, augmentent mécaniquement. De plus, cette pression a été appliquée à des activités dont les coûts sont comptabilisés précisément et débattus au parlement chaque année, mais dont la valeur est beaucoup plus mal pilotée. Ainsi, c’est une association qui nous informe sur le délai de prise de rendez-vous médicaux et des organisations internationales qui évaluent la performance de notre éducation ou de notre justice. La contrainte qui était précisément mesurée (celle pesant sur les dépenses) a écrasé ce que personne ne mesurait (la qualité ou la valeur du service pour les usagers). La complexité n’étant pas non plus mesurée, la taille des réglementations a augmenté jusqu’à dix fois plus vite que la richesse par habitant.
Même si la tendance n’est pas à la croissance des dépenses publiques, nous pouvons lutter contre cette dérosion. D’abord en concentrant nos moyens – 30 politiques publiques exemplaires sont préférables à 300 initiatives sans moyens. Ensuite en mesurant la valeur des services avec autant de rigueur que les coûts. Nous proposons également de changer de méthode sur chacun des maillons de la chaîne de conception et de mise en œuvre des politiques publiques – par exemple en sortant les faits relatifs aux enjeux les plus importants des clivages partisans (comme le COR a pour mission de le faire sur les retraites) ou en imposant plus de rigueur dans la gestion du cycle de vie des politiques publiques. Enfin, en appliquant les méthodes qui ont largement fait leurs preuves pour réduire les problèmes de qualité ou de responsabilisation des organisations trop bureaucratiques. A l’heure où c’est le niveau des dépenses qui occupe le débat, n’oublions pas que ce qui est fait de ces moyens est une question au moins aussi importante.
Vincent Champain est dirigeant d’entreprise et président de l’Observatoire du Long Term